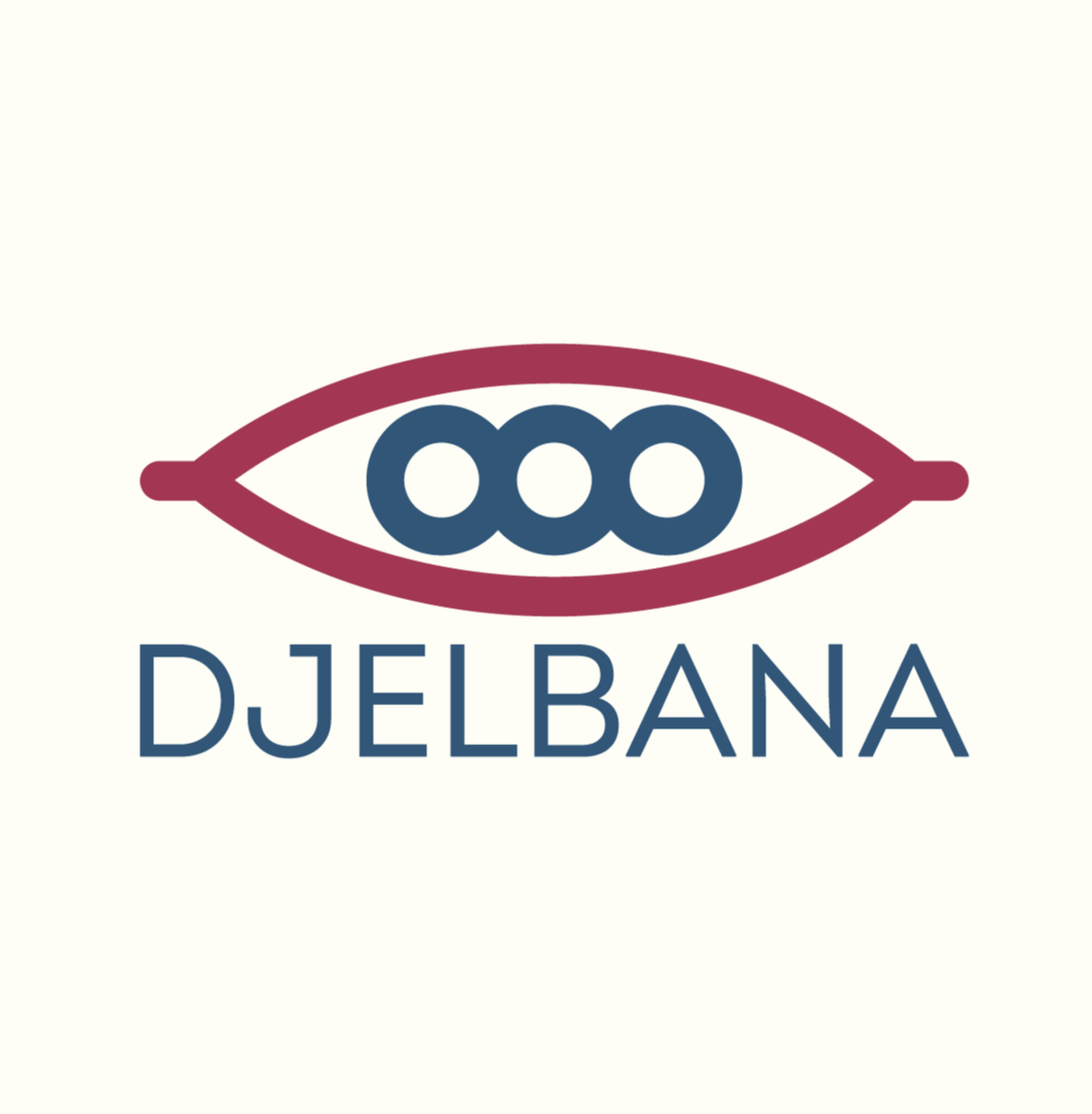60 ANS APRÈS LES ACCORDS D'ÉVIAN
AUTEUR
Un essai sous la direction de SarahDekkiche et Hasni Abidi
Sarah Dekkiche, franco-algérienne résidant en Suisse, est diplômée de l’Institut d’études politiques de Lille et de l’université de Münster en Allemagne. Son identité est imprégnée de l’histoire entre la France et l’Algérie. L’envie de comprendre et de démêler ses appartenances multiples a animé divers projets liés à son itinéraire personnel.Ce livre s’inscrit dans cette démarche
Hasni Abidi est chargé de cours au GSI de l’université de Genève et enseignant à Sciences Po Paris au sein du Campus de Menton. Il dirige en outre le Centre d’Études et de Recherche sur le Monde Arabe et Méditerranéen (CERMAM). Enfin, Hasni Abidi est membre du Panel international sur la sortie de la violence (IPEV) et auteur de plusieurs ouvrages sur la région MENA.
FICHE TECHNIQUE
Format 145 x 190mm
298 pages
EAN : 9782367602493
Prix public : 21€
TAG
#algérie, #france, #guerre d’algérie, #19-mars, #accords d’évian, #fln, #de gaulle
Il y a soixante ans étaient signés les accords d’Évian qui ont mis fin à la guerre entre la France et l’Algérie et enclenché le processus d’indépendance de l’Algérie après 132 ans de colonisation. Ce livre revient sur les coulisses des négociations et rend hommage à une laborieuse construction ayant mené à une percée diplomatique marquée par la primauté du droit, du compromis et de la liberté pour bâtir un avenir meilleur.
Si le travail sur l’histoire, sur la compréhension des mécanismes coloniaux et sur la reconnaissance des faits est essentiel, il se révèle cependant insuffisant pour guérir les blessures et répondre aux quêtes identitaires que partagent l’ensemble des acteurs. Aujourd’hui, en tant qu’enfants et petits-enfants des accords d’Évian, il apparaît important d’aller au-delà en engageant des dialogues sereins entre les différents héritiers de cette Histoire. Ainsi, en rassemblant les récits d’une variété porteurs de mémoire – témoins ou leurs proches, universitaires, journalistes et membres de la société civile affranchis de toute tutelle – cet ouvrage se veut une contribution à la construction d’une nouvelle relation autour d’un récit pluriel et apaisé.
Biographies des contributeurs
Nils Andersson
Né 1933 à Lausanne, Nils Anderssona travaillé comme éditeur en Suisse. Il prend conscience de la questioncoloniale par la lecture de L’Observateur au moment de la guerre duVietnam. En 1957, il fonde la maison d’édition La Cité Éditeur. Sonactivité éditoriale sera indissociable d’un engagement militant avec la luttedu peuple algérien, les réseaux de soutien, les insoumis et les déserteursfrançais. Ainsi, à la demande de Jérôme Lindon, directeur des Éditions deMinuit, il réédite La Question d’Henri Alleg et La Gangrène, deuxouvrages qui traitent de la torture en Algérie et qui étaient alors interditspar le gouvernement français. Il publiera d’autres documents sur la guerred’Algérie par la suite, tels que Les Disparus, La Pacification (utiliséecomme colis piégé tuant un professeur belge), L’aliénation colonialiste etla résistance de la famille algérienne, Le théâtre de Mohamed Boudia,Naissance, L’Olivier, ou encore des témoignages deFrançais comme Le temps de la justice et H.S.
Azouz Begag
Azouz Begag est né à Lyon en 1957 de parentsimmigrés algériens (Sétif) arrivés en France en 1949. Chercheur au CNRS,écrivain, il a publié en 1986 aux Éditions du Seuil, à Paris, un roman LeGone du Chaaba, adapté au cinéma, déjà vendu à trois millions d’exemplaireset traduit dans de nombreuses langues. Son identité franco-algérienne,avec ses incessants ballottements, a toujours été au cœur de son œuvre. Il aété ministre de l’Égalité des chances dans le gouvernement de Dominique deVillepin, de 2005 à 2007, sous la présidence de Jacques Chirac.
Meryem Belkaïd
Meryem Belkaïd est professeur assistante en études francophones àl’université de Bowdoin aux États-Unis. Après un master sur le monde arabeobtenu à Sciences Po Paris en 2005, elle soutient en 2012 sa thèse enlittérature contemporaine à l’université Sorbonne Nouvelle. Elle rédigeactuellement un ouvrage sur le cinéma algérien et la manière dont le genredocumentaire se développe en Algérie depuis la fin de la guerre civile. Elleest également l’auteure de plusieurs articles académiques publiés dans lesrevues Lendemains, Fixxion, North African Studies Journal,Expressions maghrébines, etc. Elle reste très attentive aux changementspolitiques et sociaux survenus dans la région du Maghreb et a publié desarticles dans plusieurs médias dont 24H Algérie et Orient XXI.
Jelil Boulharouf
Né à Belgrade en 1967, JelilBoulharouf est le fils de Taïeb Boulharouf, indépendantiste algérien engagéauprès du Front de libération nationale (FLN) et émissaire du gouvernement provisoirede la République algérienne (GPRA) en Suisse. Jelil est Docteur en médecine, diplômé de lafaculté de médecine d’Alger en 1993. Il a exercé dans les hôpitaux du grandAlger pendant des années, et s’est lancé également dans l'entrepreneuriat.
Antoine Fleury
Antoine Fleury est professeurémérite de l’université de Genève où il a enseigné l’histoire des relationsinternationales et l’histoire de l’intégration européenne de 1974 à 2008. Sesrecherches et ses publications portent sur l’histoire des relationsinternationales au XXe siècle, notamment sous l’angle desnégociations économiques et le rôle des organisations internationales,notamment la Société des Nations, l’Organisation des Nations unies (ONU) etl’émergence de la diplomatie multilatérale. Il s’est aussi investi dans desrecherches et des publications sur les relations internationales de la Suisse dansses principales dimensions en relation avec la publication de la série des Documents diplomatiques suisses dont il a assumé la direction jusqu’en 2008,cf.
www.dodis.ch
Marisa Fois
Marisa Fois est historienne à l’Institut derecherches sociologiques de l’université de Genève. Ses recherches portent surl’histoire de l’Algérie, les minorités en Afrique du Nord, le postcolonialismeet la décolonisation. Parmi ses ouvrages, ellea récemment publié Héritages coloniaux. Les Suissesd’Algérie (Seismo, 2021).
André Gazut
André Gazut est né en 1938 à Firminy, en France. Alors qu’il eststagiaire reporter-photographe au mensuel Réalités à Paris en 1956, il voit desphotos de torture prises par un collègue en Algérie. Cette découverte détermineson engagement anticolonialiste et non-violent. Quand il est appelé à l’arméetrois ans plus tard, il refuse de porter les armes. Incorporé commeinfirmier-parachutiste, il déserte en Suisse en 1960. Il sera amnistié en 1966.En 1961, il entre comme cameraman à la RTS. La même année, il couvre la délégation algérienne du gouvernementprovisoire de la République algérienne (GPRA)) participant aux négociationsd’Évian et résidant à la villa du Bois d'Avault. En 1970, il devient réalisateur pour Temps présent qu’il coproduit. Il a également réalisé plusieursdocumentaires, dont Pacificationen Algérie – 1re partie : Le sale boulot ; 2e partie : La politique du mensonge, qui dénonce la torture en Algérie.